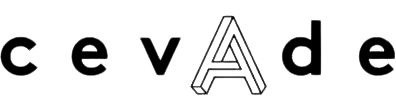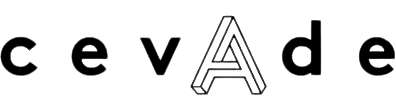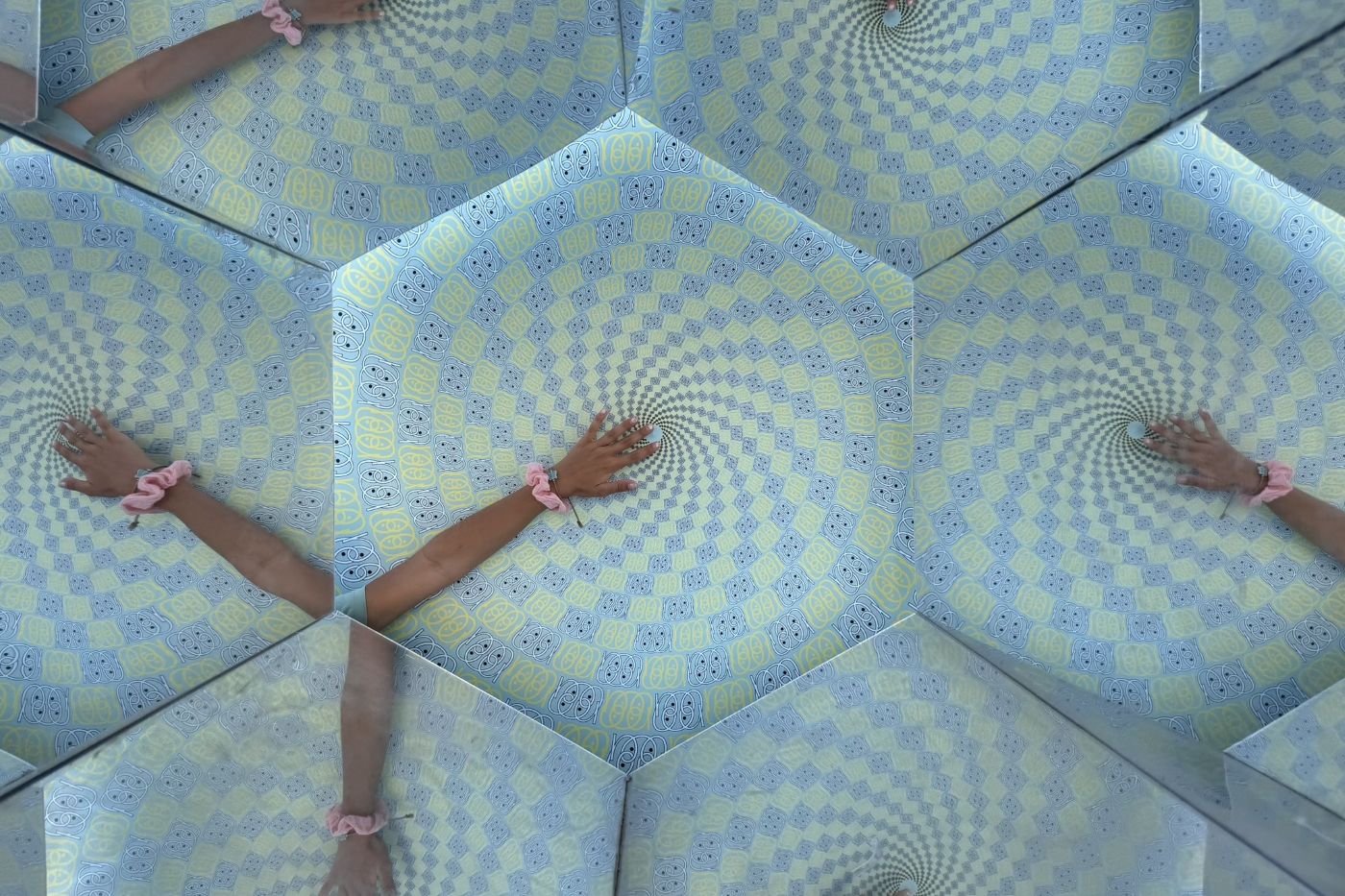regArds
L’actualité de cevAde : des propositions d’action
- 17 Avril 2025
La feuille de route est un outil structurant qui guide une politique publique dans la durée. Elle pose les bases utiles pour démontrer la pertinence de l’action et permet son évaluation. Son tableau de bord sert la mise en oeuvre de la stratégie pour apprécier les effets de l’action collective.
- 15 Avril 2025
Le cycle de vie des productions dans les arts de la scène comprend plusieurs étapes, de l’idéation à la diffusion. Prolonger ce cycle est essentiel pour des raisons économiques, écologiques et sociales. En voici six, qui sont complémentaires les unes des autres.
- 28 Mars 2025
Enseignements de la transformation de la Commission romande de diffusion des spectacles. Cet accompagnement a abouti en une stratégie structurée. Le rapport d’activités 2024 publié par La Corodis met en lumière plusieurs points clés, essentiels à l’évolution du secteur.
- 25 Jan 2023
En matière d’aménagement, la gestion d’une zone d’activités vise à garantir une utilisation rationnelle du sol. Outre la fonction d’optimisation d’accueil du développement économique, les enjeux résident dans l’intégration sociale et environnementale des activités qui s’y déploient. Une gestion des zones d’activités permet la mise en place de mesures diversifiées…
- 25 Jan 2023
Les collectivités présentent souvent les agglomérations comme un outil de financement, les partenaires du projet comptabilisent les millions reçus et vantent leurs réalisations. Par-delà la manne fédérale, c’est surtout un puissant levier pour structurer le développement du territoire, améliorer le système de transports, engager une transition vers des déplacements…
- 25 Jan 2023
Un plan de mobilité vise à réduire l’usage des transports individuels motorisés (TIM) et à inciter au report modal. La distinction entre le plan de l’entreprise et celui de la zone nécessite de préciser ce qui est du ressort de l’entreprise en interne et de ce qui peut être partagé à l’échelle de plusieurs entreprises avec la collectivité publique.
- 11 Nov 2021
On appelle rationalisation le phénomène de la multiplication des fonctions : une partie extraite de la totalité, rendue autonome, mais coordonnée avec les autres parties ayant déjà subi le même processus. Au début du XIXème siècle les efforts musculaires n’ont plus de « secrets » pour les physiologistes, mais en 1885 une nouvelle…
- 11 Nov 2021
Le bois : un allié de la transition écologique. Le bois dans la construction permet de stocker du CO2. Il participe significativement à la transition écologique lorsqu’il est façonné au sein d’un réseau de proximité, l’effet étant accentué avec la réduction des distances dues au transport. Première étape de la transformation du bois, le sciage en…
- 11 Nov 2021
Du principe de subsidiarité. La politique culturelle en Suisse repose sur le principe de subsidiarité, par lequel la responsabilité du soutien revient à l’entité compétente la plus proche de ceux qui sont directement concernés par cette action (1). Le principe d’opportunité peut parfois prévaloir comme c’est le cas du cinéma, pour lequel la…
- 3 Juin 2021
On appelle rationalisation le phénomène de la multiplication des fonctions, c’est-à-dire l’extraction d’une partie de la totalité, partie rendue autonome, mais coordonnée avec les autres parties ayant déjà subi le même processus. Ce phénomène adoptera dans les années 1920 un caractère d’universalité et d’inéluctabilité. La maison est devenue un…
- 3 Juin 2021
La cartographie est un outil stratégique qui visualise dans l’espace les activités humaines, stables ou précaires, leur concentration ou leur essaimage, dans les frontières officielles ou hors cadre. Les actrices et acteurs de la culture ont de tout temps recherché des territoires de jeu. La scène dite underground explore les quartiers oubliés de…
- 3 Juin 2021
Les plateformes de « Mobility as a service » (MaaS) centralisent des prestations commerciales de sociétés de transports ou de loisirs. C’est ainsi que dans le cadre de leur mission publique, les transporteurs nationaux comme CFF co-développent des projets pilotes tel Yumuv. Pour être attractifs, ces portails digitaux doivent pouvoir présenter une…
- 16 Nov 2020
L’offre pour la mobilité de partage est peu attractive et peu diversifiée, elle n’est présente que dans quelques centres urbains. Cette situation résulte d’une absence de coordination des…
- 16 Nov 2020
Cette période de pandémie Covid-19 agite l’équilibre fédéraliste. En Suisse, les politiques culturelles présentent des missions, objectifs et tâches fort variables selon les cantons et les communes. Les statistiques fédérales font ressortir ces différences sous l’angle des moyens attribués. Ainsi, 50% du financement public vient…
- 16 Nov 2020
Entre aménagement du territoire et développement économique, la problématique du développement des zones d’activités est aussi complexe que cruciale dans l’objectif d’une transition écologique. Le récent système de gestion de ces zones mis en application par les Cantons tente de résoudre le problème du mitage du territoire en densifiant les…
Médias
Parution d’articles

- 17 Juin 2020
Développement touristique de nature
Lire l’article 24Heures_plan d’affaires détaillé (juin 2020)
Relier le Jura au Lac. Un plan d’affaires montre que l’exploitation de « La Liberté » peut être rentable si le bateau dispose d’un ponton.

- 17 Jan 2020
La transition énergétique passe par la mobilité de partage
La mobilité de loisirs est la plus grande consommatrice de CO2. Elle génère le plus de déplacements avec une distance moyenne parcourue par personne et par jour en Suisse de 14.8 kilomètres dont 9.7 kilomètres en transport individuel motorisé (2015). Au quotidien, il s’agit de courtes distances parcourues en transport individuel motorisé et effectuées en voiture individuelle (63.8%). Mais si les chiffres sont si explicites, qu’en est-il dans les faits des politiques publiques pour favoriser une mobilité de loisirs qui contribue à la transition énergétique?