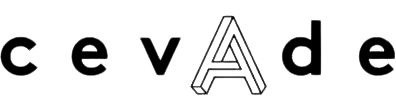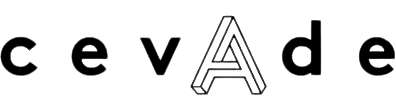La durabilité des arts de la scène
- par cevAde | Avril 15, 2025
Un défi de taille
Le cycle de vie des productions dans les arts de la scène comprend plusieurs étapes, de l’idéation à la diffusion. Prolonger ce cycle est essentiel pour des raisons économiques, écologiques et sociales. En voici six, qui sont complémentaires les unes des autres.
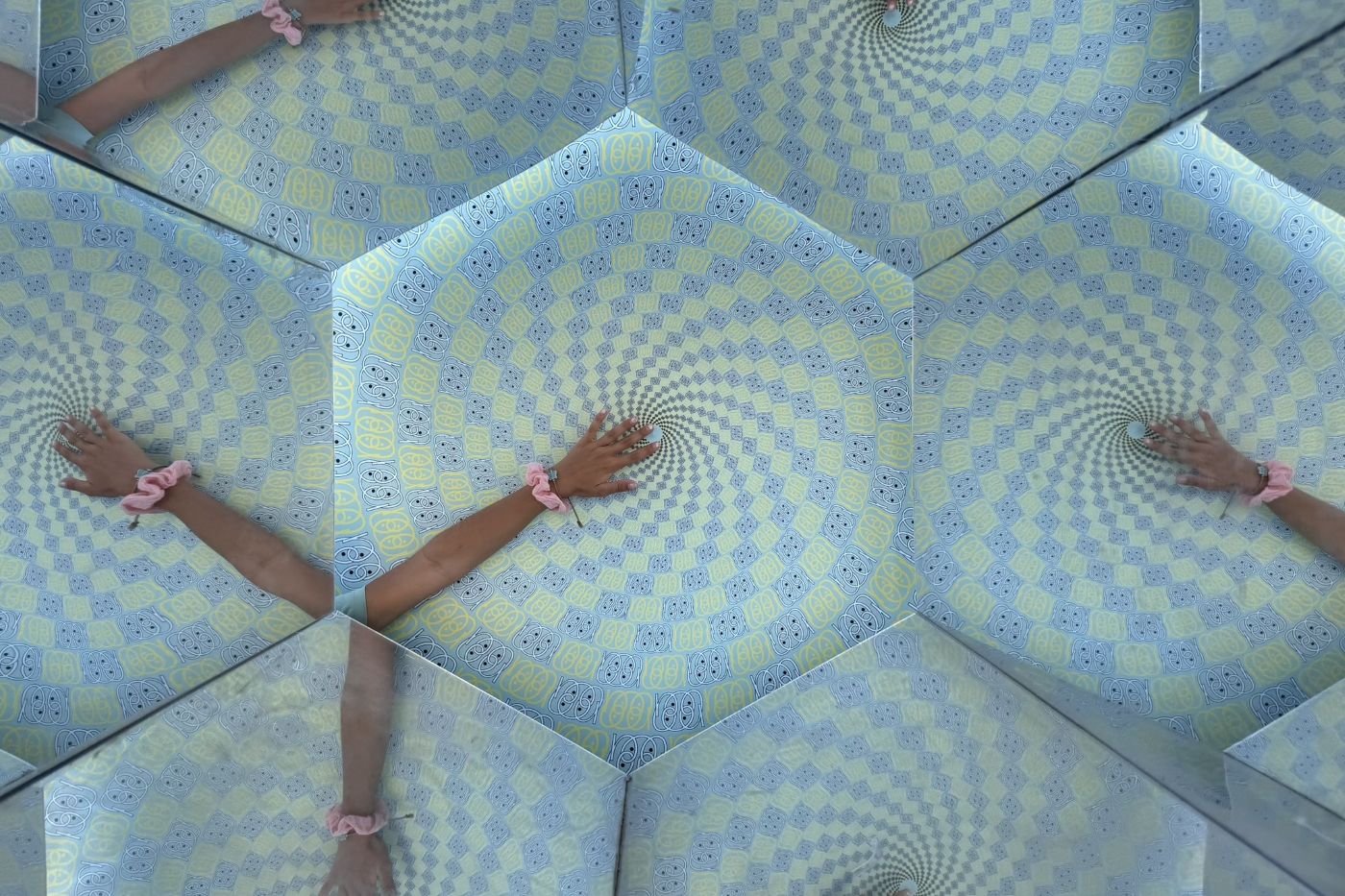
Le cycle de vie des productions dans les arts de la scène suit des étapes de travail distinctes. D’abord initié par l’idéation autour d’un projet, la création scénique et la production peuvent se réaliser lorsque le financement du budget établi permet d’assurer que les conditions de rémunération et de production sont réunies. La diffusion boucle le cycle et dure aussi longtemps que les dates négociées avec les structures productrices et organisatrices (les théâtres, festivals et gestionnaires de salles dédiées, etc.) le permettent. Une telle production peut être adaptée et reprise dans les deux à trois années qui suivent et nécessite un budget adéquat pour assurer ce renouvellement du cycle de vie de la production. Ces reprises sont des indicateurs positifs de la longévité du cycle de vie d’une production et constituent aussi un retour sur l’investissement humain et financier significatif.
Les six raisons de prolonger le cycle de vie d'une oeuvre
L’intérêt de prolonger la durée du cycle de vie est évident pour ces six raisons, tout en veillant à ne pas fixer cette durée comme un dogme, certaines créations scéniques étant impactantes dans l’éphémère et non dans la continuité.
- Les conditions de rémunérations professionnelles, qui tiennent compte du cadre contractuel de court terme et de production mesurée dans un contexte de crise climatique.
- La reconduction de représentations à deux voire trois dates par lieu est encouragée pour limiter l’empreinte carbone du transport, renforcer la médiation auprès du public ciblé lorsque cela fait sens, et optimiser la communication, qui est un coût budgétaire certain. Bien souvent, les conditions d’accueil dans les structures productrices et organisatrices (théâtres, festivals) et la promotion du spectacle n’assurent qu’une seule représentation, pour des raisons budgétaires, parfois par peur de manquer de public ou pour des questions d’agenda.
- Les engagements des structures qui, en accueillant un spectacle, participent à sa durabilité écologique, sociale et économique : autant sur les conditions de rémunération que sur le nombre de représentations programmées.
- La structure qui produit un spectacle veille aux conditions de l’emploi de ses équipes, aux modes de transport durables durant la tournée et à combiner le circuit de la tournée, dans la mesure du possible.
- La complémentarité des financements publics ou parapublics qui harmonisent les moyens du début du cycle de vie à son terme en encourageant le renouvellement et le réemploi de productions passées. La coresponsabilité de la Confédération par l’intermédiaire de Pro Helvetia, des cantons, des villes et des communes qui doivent coordonner leurs politiques culturelles.
- Une meilleure lisibilité des arts de la scène et de leurs œuvres par tout un∙e chacun∙e, permise par une durée de tournée allongée avec des dates mieux réparties sur le territoire.
Cette transformation est collective et engage autant les milieux professionnels que les milieux politiques responsables de leurs soutiens publics. Elle s’inscrit dans le long terme avec comme résultante l’impact positif des productions scéniques sur leur environnement et les effets favorables sur les parcours professionnels.